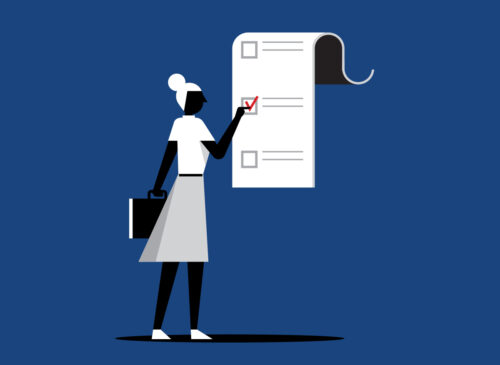shutterstock
L’été dernier, une amie m’a remis le livre The Slow Professor de Maggie Berg et Barbara K. Seeber, qui m’a beaucoup fait réfléchir. Au moment d’entrer en poste dans une université, après plusieurs années de stages postdoctoraux, je me suis demandé pourquoi, en effet, ne pas ralentir ?
Ce livre prône les avantages d’un ralentissement généralisé à l’université . Les autrices se demandent comment réformer l’université de l’intérieur en luttant contre la course à la performance et la culture de la vitesse qui la caractérise. Comment inverser la tendance lourde qui la marchandise et qui moule les objectifs pédagogiques aux normes du marché ?
Les autrices interrogent à la fois la responsabilité individuelle des professeurs d’agir conformément aux idéaux nobles de l’institution, et les possibles mobilisations collectives pour la sauvegarde de l’indépendance de l’université.
Le livre pose en filigrane une question difficile : à quel point les professeurs ne plient-ils pas eux-mêmes à l’idéologie de la croissance à leur insu?
Éloge de la lenteur
Berg et Seeber ouvrent donc la possibilité, par la lenteur dont elles font l’apologie, de pratiquer une certaine dissidence au sein même de l’université, d’avoir des pensées – et des pratiques – divergentes –, et de faire de l’université un lieu habitable.
L’idée de décroissance, dans l’univers économique, se fonde sur l’idée qu’une catastrophe écologique est inévitable tant que l’on soumet l’exploitation des ressources (finies) à la croissance (donc à l’exploitation infinie).
Il me semble que les idées chez un professeur ne sont pas renouvelables au même rythme que l’exploitation des esprits induite par le système universitaire, surtout si elles sont soumises à une pression constante.
On somme les professeurs de produire toujours plus, ignorant les aléas de la vie (fatigue, dépression, grossesse, vieillissement). Cette dichotomie entre la créativité et la surproduction intellectuelle crée parfois une dissonance et donne l’impression que certains font l’étalage d’idées appauvries.
On constate des phénomènes semblables dans les domaines artistiques, alors que les artistes se sont transformés en « producteurs culturels ». J’ai souvenir d’une entrevue avec la peintre Agnes Martin, qui justifiait d’avoir jeté aux ordures toutes ses tentatives jusqu’à ses 40 ans en disant : « Cela prend du temps pour créer quelque chose de neuf. »
Le mythe du fonctionnaire
Être en phase avec son intériorité sans être constamment menacé par l’extériorité est une exigence tout aussi valable pour un chimiste que pour un peintre. On ne peut pas produire du neuf sans laisser du temps aux idées pour se régénérer.
Mais avant même d’aborder de front la vitesse elle-même, il faut critiquer un discours sur le temps qui contamine la discussion. Il suffit d’avoir mis les pieds dans une université pour savoir que tout le monde prétend ne pas avoir de temps, fléau universel, mais qui atteint un niveau délirant pour les professeurs d’université : retard de plusieurs mois dans les réponses de courriels, dans l’évaluation de mémoires et de thèses, etc.
La méconnaissance de la variété de la tâche des professeurs peut parfois entretenir des préjugés à leur égard : ils travailleraient peu, logés dans une oisiveté passive, obtenant un salaire généreux, voyageant aux frais du public.
Ces préjugés sont recevables, pas forcément faux, mais à condition de s’aligner sur l’entreprise privée, ce qui n’est peut-être pas souhaitable quand on y pense une seconde, car pourquoi souhaiterait-on que tous les travailleurs soient mal payés et n’aient droit à aucun enrichissement intellectuel?

shutterstock
Ces préjugés sont grosso modo ceux qui touchent l’ensemble du secteur public. Les gouvernement de la Coalition avenir Québec (CAQ), au Québec, et du Parti progressiste-conservateur de l’Ontario, ne vont rien arranger à la chose, alors qu’ils ont déjà déclaré vouloir accélérer l’adaptation de l’université aux besoins du marché du travail.
Berg et Seeber parlent surtout de la nécessité de réintroduire dans la vie universitaire la notion de timelessness, une sorte d’intemporalité qui est, selon elles, au cœur même de l’inventivité et de la créativité. Elles soumettent l’idée qu’il est virtuellement impossible de lire et d’écrire (activités qui sont au centre même de la vie universitaire) en ayant une trop grande conscience du temps qui passe.
Réapprendre à se couper du monde
Sur ce point, il semble que tout le monde devrait être interpellé par une telle revendication. Il est évident que le temps de concentration de tout un chacun est fortement entamé par les sollicitations extérieures de plus en plus fréquentes.
Sans plaider pour l’abolition de Facebook ou des textos, Berg et Seeber estiment néanmoins qu’il faut réapprendre à se couper du monde, ne serait-ce que quelques heures, pour pouvoir lire et écrire correctement. Transformer le savoir et se laisser transformer par le savoir des autres exigent de la lenteur, presque une ascèse.
Le principe du slow professor implique aussi une manière de hiérarchiser différemment la vie intellectuelle et la vie matérielle, de trouver une manière de ménager de la place pour les occupations prosaïques.
Cette culpabilité de ne jamais travailler assez est en train d’envahir toutes les sphères du travail immatériel. J’ai d’ailleurs écrit un article dans la revue Nouveau Projet sur cette question, et plus particulièrement sur « l’humour universitaire » qui tourne en dérision cette obsession du travail et l’aliénation qui en découle.
Inutile de préciser que cette gestion du temps est contraire à celle de la parentalité, plus particulièrement à la maternité, ou à toute autre forme d’investissement dans les soins de ses proches. (Il s’agit certainement là d’une piste à suivre si l’on veut comprendre les inégalités systémiques liées au genre à l’université.)
Savoir remettre la vie familiale, sociale et créative au cœur même de l’économie du savoir est peut-être la seule manière de sauver l’université de cette déroute qu’elle s’est elle-même imposée dans une volonté de singer l’entreprise privée. À quel point les professeurs ne sont-ils pas eux-mêmes complices de cet emprisonnement, comme s’ils avaient eu peur d’être accusés d’être paresseux, sous la pression d’un discours adverse qu’ils ont intégré ? Il s’agit là d’un cas classique d’hégémonie, où l’adhésion aux valeurs des dominants devient si puissante qu’elle est indiscernable, comme l’air (vicié) que l’on respire.
Faire moins…et mieux
La disponibilité intellectuelle dont je parle est tout particulièrement importante à un moment où l’université est le lieu de ré-élaboration de la notion même de culture en lien avec des luttes de pouvoir (liées à la diversité culturelle, aux notions de genre, à la domination masculine) et qu’il faut savoir entendre ce que les étudiants et les étudiantes ont à dire sur ce mouvement de fond. Pour le dire simplement, l’université ne peut se permettre d’être un univers technocratique aseptisé en ce moment, ce serait tout simplement politiquement irresponsable.
Il est temps de faire moins et mieux, pour transmettre aux étudiants quelque chose comme une puissance, voire une jouissance critique. Réinstaller la camaraderie, l’entraide, les rencontres réelles, les échanges gratuits, briser l’isolement. Cela implique, il est vrai, d’accepter aussi une forme de vulnérabilité de sa parole, de ne pas se blinder contre l’avis des autres, de ne pas avoir peur d’être pris en défaut.
C’est vrai pour l’université, mais aussi pour tous les milieux de savoir, de créativité, de travail en communauté. Être de lents professeurs, de lents journalistes, de lentes infirmières, ce n’est pas être arrêté – c’est simplement retrouver le luxe de jouer avec ses idées et son énergie, afin que les valeurs comme la créativité et l’invention, la sollicitude, ne soient jamais soumises à la surenchère spéculative.
(Ce texte a préalablement été publié, dans une version longue, dans le numéro 323 de la revue Liberté, sous le titre «Détaler comme un lapin».![]()
Julien Lefort-Favreau, Assistant Professor, French Studies, Queen’s University, Ontario
This article is republished from The Conversation under a Creative Commons license. Read the original article.